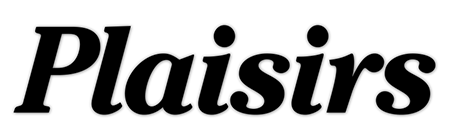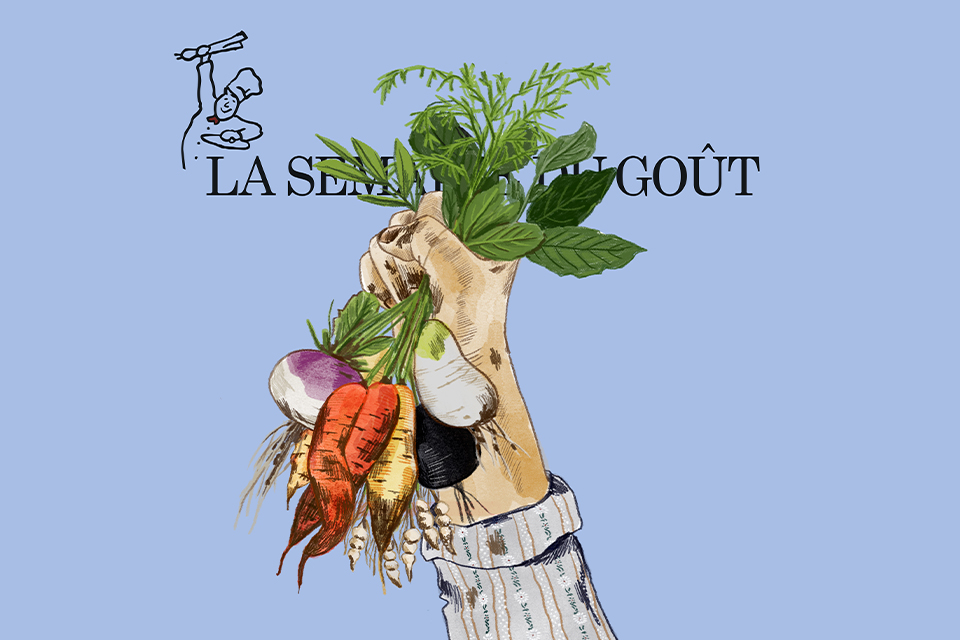Véritable joyau, Milan, surnommée la “Cité de la Mode”, est une splendide métropole située au cœur de la fertile plaine lombarde. Oscillant entre un passé historique opulent et un futur résolument avant-gardiste, Milan incarne l’esprit contemporain de l’Italie. La ville […]